usage
La dinde des Rois

Pourquoi le vieil usage de servir une dinde rôtie le jour des Rois ? Ce fut, dit la chronique, le jour de l’Epiphanie que ce gallinacé d’élite l’ut savouré pour la première fois, en France, sur la table royale, non de Charles IX, mais de Louis XII. En embrochant la dinde de l’Epiphanie, ou célèbre, sans s’en douter, un grand anniversaire de conquête gastronomique. C’est à la fois une date mémorable pour la table et le poulailler.
C’est au temps de la Renaissance que des moines portugais introduisent la pintade en France. C’est au commencement du XVIe siècle que des moines espagnols importent de l’Amérique du Nord le dindon en Europe. Sa domestication ne fut qu’un jeu, grâce a l’excellente nature de ce gallinacé qui semble né pour le tourne-broche.
Si l’oie gauloise fut détrônée par le dindon américain, la vieille poule française conserva son immuable royauté, le sceptre des étables, la couronne des basses-cours.
La bonté de sa chair acclame et distingue le dindon. Sa tenue est correcte et sympathique si l’on en excepte une pointe de vanité qui le pousse à faire la roue. Son gloussement pittoresque et familier n’a pas les éclats autoritaires des fanfares du coq qui semble avoir ramassé ses clairons sur les bords de la Garonne.
Picorant dans les champs, sur la lisière des bois, le dindon demande peu de soins, peu de grains. On l’élève avec profit, on le nourrit sans peine. Il pèse lourd, coûte peu, se vend cher. Nos meilleurs dindons de France sont ceux du Berry, de la Touraine, de l’Anjou, du Périgord, surtout de la Vendée, où l’on rencontre des troupeaux de trois à quatre mille dindons, processions interminables qui ondulent et serpentent dans les champs ponctués de robes noires, égayés de gloussements sonores qui s’appellent, se répondent, se confondent, éclatent en notes jaillissantes et précipitées pour s’étendre, à l’horizon, dans on ne sait quel finale étrange et confus d’une mélopée lointaine qui s’éteint.
Dans les vastes plaines de l’Ohio et du Mississippi, se rencontrent d’immenses troupes de dindons sauvages dont les gloussements font retentir les solitudes. Que de rôtis succulents perdus pour l’humanité ! Loin des truffes et des marrons du Périgord, ils picorent en sécurité et font la roue en paix. Ces dindons à l’allure vive et libre, au joli plumage blanc, roux, noir, café au lait, aux pattes infatigables et légères, sont la souche vénérable de nos dindons domestiques.
Le dindon n’est pas, comme la pintade, rebelle aux charmes de l’étable et de la civilisation. Ce doux sauvage ne demande qu’à s’apprivoiser, qu’à venir émailler nos prairies et réjouir nos lèchefrites. Le dindon des forêts américaines se domestique si facilement, qu’il suit volontiers dans les fermes les dindons privés rencontrés à la promenade. En face des auges bien garnies, il semble dire dans un gloussement de satisfaction : « On est bien ici, restons-y ! » et il reste, il est mûr pour l’esclavage et la rôtissoire.
Pour un grain il a vendu sa liberté. Le voilà conquis aux honneurs de la civilisation et des casseroles.
« Le Chenil. » Paris, 1891.
Peinture : Frank Moss Bennett.
Le pour-boire réformé
 En Angleterre, un particulier ne peut aller dîner nulle part, même chez son ami, qu’il ne donne un pour-boire plus ou moins considérable aux domestiques de la maison, et cela, selon la plus ou moins grande dignité des maîtres.
En Angleterre, un particulier ne peut aller dîner nulle part, même chez son ami, qu’il ne donne un pour-boire plus ou moins considérable aux domestiques de la maison, et cela, selon la plus ou moins grande dignité des maîtres.
Cet usage exacteur choque surtout les étrangers, et beaucoup d’Anglais ont fait d’inutiles efforts pour le réformer. Cependant il a été aboli, il y a cinquante à soixante ans, dans presque toute l’Ecosse. Les juges de paix, les propriétaires de fiefs, en ont donné l’exemple en prenant la résolution, dans leurs assises, de ne donner jamais d’argent aux domestiques des autres. Ils furent ensuite imités par divers particuliers. Enfin les secrétaires du sceau, en Écosse, firent insérer, dans les papiers publics, la délibération suivante :
« Cejourd’hui, les secrétaires du sceau ayant examiné l’usage de donner, sous le nom de pour-boire, de l’argent aux domestiques, il leur a paru que cette pratique était nuisible aux mœurs des domestiques; qu’elle n’est en usage chez aucune autre nation; qu’elle déshonore la police de ce royaume; qu’elle met un obstacle à l’hospitalité, et qu’elle impose une taxe sur le commerce social des amis.
En conséquence, ils sont convenus unanimement de concourir, avec les personnes et les sociétés honorables qui ont donné un exemple louable en abolissant cette pernicieuse coutume, et ils ont résolu qu’à compter de la Pentecôte de cette année, chaque membre de la société défendrait expressément à ses domestiques de recevoir de l’argent de quelque personne que ce soit; qu’après ce terme, aucun membre de la société ne donnerait d’argent à aucun domestique, et ils ont ordonné que cette délibération serait rendue publique. »
Cette résolution excita un soulèvement général parmi les domestiques d’Écosse, que l’on prit soin d’apaiser. Leurs gages furent augmentés,et l’on peut voyager actuellement dans ce royaume, sans payer son gîte et son dîner, chez ses amis, quatre fois plus cher qu’à l’auberge.
César Gardeton. « La Gastronomie pour rire. » Paris, 1827.
Un repas aux oiseaux
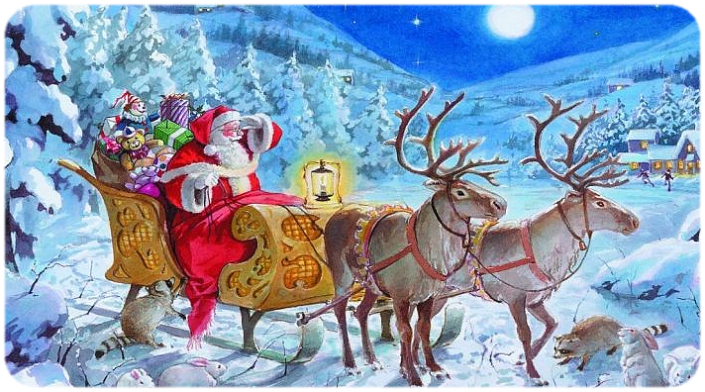 C’est un usage assez répandu, en Suède et en Norwège, d’offrir, le jour de Noël, un repas aux oiseaux.
C’est un usage assez répandu, en Suède et en Norwège, d’offrir, le jour de Noël, un repas aux oiseaux.
La dernière gerbe de la moisson est soigneusement conservée, chez les pauvres comme chez les riches, jusqu’à la veille de la grande solennité. Le vingt-cinq décembre, au matin, on la fixe au bout d’une perche et on en décore le pignon de la maison. C’est un charmant et étourdissant concert que celui de la gent granivore faisant tapage autour de ce mât pour picorer les épis de blé. Tous les petits habitants de l’air prennent, eux aussi, leur joyeux festin et rendent grâces à la Providence qui, dans un jour si heureux, a voulu les combler d’allégresse. Cette ravissante coutume suédoise nous rappelle ces deux vers si connus :
Aux petits des oiseaux il donne leur pâture
Et sa bonté s’étend sur toute la nature. (1)
Un de nos meilleurs poètes a gracieusement chanté ce Réveillon des petits oiseaux :
Et les oiseaux des champs ? Ne feront-ils la fête ?…
Eux que l’hiver cruel décime tous les jours.
Eux que le froid transit, que la famine guette
Sur l’arbre dépouillé du nid de leurs amoursOh, non Pour eux, l’on cherche une gerbe emmêlée
Où des milliers d’épis se courbent sous le grain,
On l’étend sur la neige : « Accourez gent ailée,
« Car votre nappe est mise, et prêt est le festin ! »Et vous voyez d’ici le pinson, la fauvette,
Le menu roitelet voleter à l’appel.Tont en mangeant le grain, ils relèvent la tète,
Pour lancer une gamme, un cri de joie au ciel. (2)
(1) Racine, Athalie, acte II, scène VII.
(2) Comtesse O’ Mahony.
« Noël dans les pays étrangers. » Monseigneur Chabot. Pithiviers, 1906.
L’empereur de Chine en balade

On n’est pas Fils du Ciel pour cheminer sur la terre comme un simple mortel. Voici comment l’empereur de Chine se promène, notamment quand il va visiter, comme, il l’a fait dernièrement, les tombeaux de son impériale famille.
Le Fils du Ciel a fait le voyage dans un palanquin à seize porteurs. (Qu’est-ce que le vulgaire attelage à six ou à huit… chevaux des monarques européens auprès de cela !) Parmi les nombreux personnages de la suite, on remarquait les présidents des treize ministères, qui seuls étaient autorisés à se servir de chaises à porteurs. L’escorte particulière de l’empereur se composait de cinquante cavaliers. En sortant du palais, le cortège s’engagea sur une route nivelée pour la circonstance avec un soin admirable.
Selon le cérémonial en usage en Chine, défense avait été faite à la population de paraître dans les rues au moment du passage de l’empereur. Mais les humbles sujets avaient percé des petits trous dans les murs de leurs maisons, afin de pouvoir contempler les traits du Fils du Ciel et de l’impératrice régente.
Lorsque l’immense procession arriva dans la campagne, la consigne devint moins sévère : on permit aux paysans d’assister au passage du cortège, mais tous devaient s’agenouiller a une vingtaine de mètres de l’empereur.
« La Revue des journaux et des livres. » Paris, 1885.
Les premiers fards romains

Ce n’est certes pas dans les premiers siècles de la République romaine que l’on trouve l’usage des fards : les femmes partageaient les vertus héroïques et les moeurs sévères de leurs maris et ignoraient tout artifice de toilette. Mais quand, par la conquête du monde, ils introduisirent chez eux la richesse, les Romains y ramenèrent en même temps le luxe et la coquetterie, comme plus tard, les croisés de retour d’Orient, devaient rapporter en Europe l’élégance musulmane.
Bref, c’est à cette époque que les Romaines commencèrent à se farder, mais d’un fard qui était fort grossier, car ce n’était pas autre chose que de la terre de Chio ou de Samos délayée dans du vinaigre. Puis les Romaines firent usage du blanc de plomb, quoiqu’elles connussent déjà ses inconvénients. quant aux fards rouge, on les tirait des végétaux ou de la dépouille des animaux.
Ce qui était encore plus grossier, c’est la façon dont on appliquait le fard sur la figure. L’esclave chargée de farder sa maîtresse devait mélanger le fard avec sa salive, ainsi qu’un auteur latin l’explique en détail :
« L’esclave, avant de commencer l’importante opération, souffle sur un miroir de métal et le présente à sa maîtresse. Celle-ci sent à l’odeur si la salive est saine et parfumée. Elle sait ainsi si elle a mâché les pastilles qui lui sont ordonnées, parce que c’est avec sa salive que l’esclave doit broyer le fard et l’appliquer, afin de l’étendre également et de le fixer sur les joues de sa maîtresse. »
Brrr… On a heureusement fait quelques progrès depuis. Sans cela nos actrices refuseraient énergiquement de se farder.


Vous devez être connecté pour poster un commentaire.