Meuse
Jeanne l’aristo

Allons ! Bon ! Voici que Jeanne d’Arc, dont on à fêté dimanche le 500e anniversaire, n’était pas du tout une paysanne, ni une bergère !
L’abbé Mandre, curé de Damvilliers, dans la Meuse (1742-1820), a écrit jadis que le père, Jacques d’Arc, et la mère, Isabelle Romée, n’étaient, point, de pauvres laboureurs, mais des gentilshommes campagnards possédant 20 hectares de terre qu’ils faisaient valoir eux-mêmes.
Jehanne était une demoiselle de château, parfaitement au courant de la politique et des faits généraux qui se passaient en France. Elle a conduit les troupeaux de ses parents et ceux de ses voisins, à son tour de rôle, partageant, la besogne selon l’usage avec les autres filles du pays, selon l’usage patriarcal de ces temps sans snobisme.
Et voilà !
La famille Jeanne d’Arc était une famille d’aristos. La fête devient, dès lors, anti-démocratique. L’abbé Mandre avait bien besoin de venir nous raconter ça !
Les miracles de Notre-Dame du Répit
Dans le petit village d’Avioth (Meuse) s’élève une somptueuse basilique dont la construction au XIIIe siècle s’explique par la découverte, deux siècles plus tôt, d’une statue miraculeuse de la Vierge.

Les pèlerins qui venaient implorer cette dernière déposaient leurs offrandes dans la Recevresse, une élégante chapelle de forme hexagonale. A une époque où le nombre d’enfants mort-nés et la mortalité infantile étaient très élevés, les nourrissons décédés avant d’avoir été baptisés ne pouvaient être enterrés, chrétiennement, ni aller au paradis. De nombreux parents transportaient donc le corps de leur enfant jusqu’à la statue miraculeuse d’un sanctuaire à répit. Ils attendaient le signe de vie (changement de couleur, mouvement du corps, saignement, sueur chaude) qui permettrait de le baptiser.
On estime à 135 le nombre de miracles qui y furent recensés, entre 1625 et 1673. A la fin du XVIIe siècle, l’évêque de Toul interdit la pratique des répits. Le pape la condamna en 1729. A Avioth, elle perdurera clandestinement jusqu’au milieu du XIXe siècle.
« A la découverte de la France mystérieuse. » Sélection du Reader’s Digest. Mai 2001.
Pauvre père Carnaval

Dans le pays de Vireux, la jeunesse confectionnait un immense pantin en paille qu’elle affublait d’oripeaux, de vêtements loqueteux aux couleurs criardes et qu’elle fichait à califourchon sur une perche. Elle le promenait ensuite dans tout le village en gémissant :
« Pauvre père Joseph ! Pauvre père Carnaval ! c’est fini ! tu vas mourir ! »
Et quand cette promenade, simulant des funérailles, était terminée, on se dirigeait vers la Meuse. Arrivés sur la berge, les gémissements, les pleurs, les hurlements recommençaient plus abondants, plus attristés. Enfin, lorsqu’on avait loyalement et suffisamment plaint ce pauvre « père Joseph », on le descendait de sa perche, on le brûlait et ses cendres étaient jetées à l’eau.
Dans quelques autres communes, on substituait à ce mannequin un jeune homme en chair et en os que l’on revêtait de foin et de paille et qu’ensuite on conduisait sur la place. Là, on simulait un tribunal qui, séance tenante, jugeait et condamnait à mort ce pauvre Mardi-Gras, représenté par le compère bénévole. On l’adossait ensuite à l’une des maisons de la place, comme un soldat que l’on colle au mur devant le peloton qui va le fusiller, et on tirait sur lui à blanc.
Malheureusement, à Vrigne-aux-Bois, un de ces Mardis-Gras improvisés, nommé Thierry, fut tué par une bourre que, par mégarde, on avait laissée dans le fusil. Quand il tomba, tout le monde applaudit à la manière merveilleuse dont il jouait son rôle. Mais, comme il restait toujours étendu, on courut à lui et on ne releva qu’un cadavre.
Depuis ce triste événement, on a renoncé pour toujours, dans les Ardennes, à ce simulacre d’exécution.
Grande découverte d’un monstre extraordinaire
Ce Monstre fut découvert dans la forêt des Ardennes, où il se retirait dans une caverne au bord de la Meuse.
Il est amphibien ; sa longueur est d’environ douze pieds ; il a une figure humaine, une bouche énorme, garnie de longues défenses ; ses oreilles ont sept pouces de long, et ressemblent à celles d’un mulet ; sa tête est hérissée de serpents, qui paraissent être fixés en place de cheveux ; son corps, dont la peau est tigrée, ressemble à celui d’une femme ; ses bras sont faits comme ceux d’un homme ; il a les cuisses d’un bouc, garnies de longs poils, et les pattes d’un griffon ; il porte des ailes de chauve-souris, garnies de poils et de piquants ; sa queue est couverte d’écailles, qui la rendent impénétrable aux coups de feu ; elle a de plus des nageoires, et se termine en forme de dard, dont il se sert pour enlever les bestiaux.
Ce Monstre est toujours accompagné d’un petit dragon ailé, qui se tient sur sa queue, et lui aide à fixer sa proie.
Il fut détruit, dans le courant de germinal, par des habitants des bords de la Meuse, qui, l’ayant surpris, parvinrent à en purger la terre. Il a été empaillé, et l’on espère bientôt l’offrir à la curiosité du public.
« Grande découverte d’un monstre extraordinaire, dans la forêt des Ardennes… » Thomas, Paris. BNF.


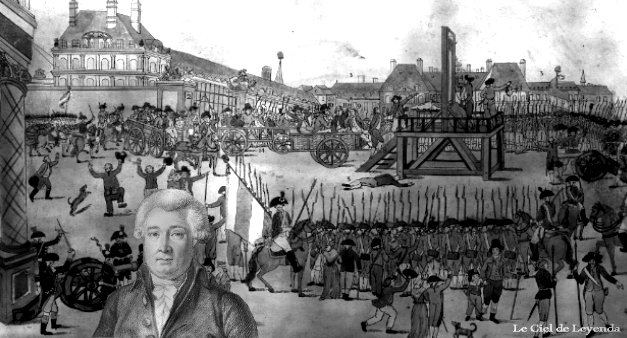
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.