Gazette
Les cures merveilleuses

La Gazette de Santé, qui paraît avoir pris en haine les médecins du temps passé, contient une anecdote fort peu honorable sur des confrères du 14e siècle.
Elle raconte que, du temps de Frédéric II, les médecins de Salerne ayant appris que les bains de Pouzzoles faisaient des cures merveilleuses, s’empressèrent d’en détruire les bâtiments, mais que par une juste punition de cet attentat, ils furent engloutis sous les eaux, avec la barque qui les ramenait.
On pardonnerait à Molière le récit d’une pareille anecdote, mais quel médecin pourra, de sang froid, la voir dans une gazette de santé ?
« Journal des arts, de littérature et de commerce. »Paris, 1812.
Dieu lui-même
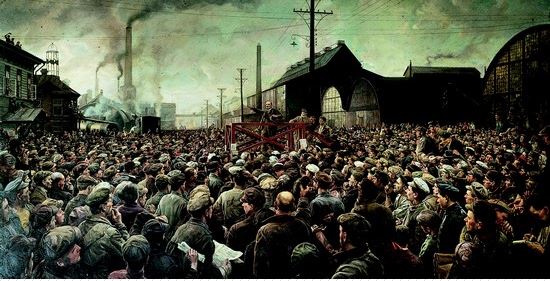
On avait lu devant la tsarine le manifeste, publié par les journaux, par lequel la Russie proclamait sa résolution de se libérer du régime tsariste. Et la tsarine, irritée, les yeux gonflés de larmes, se refusait à croire.
— Je ne me fie qu’à l’Armée et ne redoute que Dieu, répétait-elle. Je méprise les perturbateurs et leurs gazettes vulgaires.
Puis s’adressant au grand-duc :
— Je vous en prie, rappelez du front nos meilleurs régiments. L’armée nous est fidèle; le peuple nous appartient. Et si même ceux-là nous trahissaient, Dieu est avec nous, et il sauvera le trône.
— Madame, répondit le grand-duc, Dieu lui-même adhère à la révolution.
Origine du journalisme en France
Le médecin Théophraste Renaudot, le fondateur du journalisme en France, commença par ramasser de tous côtés des nouvelles pour amuser ses malades.
Ainsi, il se vit bientôt plus à la mode qu’aucun de ses confrères.
Mais comme toute une ville n’est pas malade, ou ne s’imagine pas l’être, il réfléchit, au bout de quelques années, qu’il pourrait se faire un revenu plus considérable en donnant chaque semaine au public des feuilles volantes qui contiendraient les nouvelles de France et de divers pays.
Il fallait une permission royale. Il l’obtint avec privilège en 1632.
Mais il y avait longtemps déjà, à cette date, qu’on avait imaginé de pareilles feuilles à Venise, et on les avait appelées gazettes, parce qu’on payait pour les lire une petite pièce de monnaie du nom de gazetta.
« Magazine universel. » Paris, 1903.
« Menteur comme une gazette »
Je crois bien que de tous les milliers de journaux qui se sont publiés en France, depuis le premier numéro du Journal des Savants, fondé en 1665 par un conseiller du parlement, pas un encore n’a fait mentir ce respectable écho de l’opinion publique sur la créance que méritent nos chroniqueurs et nos feuilletonistes.
A qui la faute ? Il y a des gens qui prétendent qu’elle est au lecteur, ou plutôt à l’abonné. « Il faut des nouvelles, disait, il y a quelques années, lors de la grande vogue du faits divers, un de nos plus spirituels journalistes; quand il n’y en a pas, il en faut faire. »
On n’est pas bien fixé sur l’étymologie du mot gazette. Quelques-uns croient qu’il vient du latin gaza dont on fait gazetta, ce qui signifie « petit trésor ». Mais ce n’est pas là l’avis de tout le monde. On a aussi expliqué l’origine de ce mot par le sens qu’il semble comporter : gazette, « feuille légère comme la gaze ». Enfin, il y a une troisième étymologie dont nous ne parlerons pas, parce que son authenticité ne nous paraît pas suffisamment établie.
Quel est le peuple auquel on attribue l’invention des journaux ? On n’en sait rien. Quant à nous, nous sommes presque assuré que la gazette est née française. Cette invention-là porte le cachet de notre nation. Aucun peuple n’a dû penser avant nous à bavarder ainsi tout haut, à afficher ainsi au grand jour ses causeries familières, les bruits intimes qui courent du palais au salon, du salon au carrefour.
Sainte-Foix attribue l’origine des papiers-nouvelles (new’s papers, comme on dit en anglais) à un médecin nommé Renaudot, qui recueillait partout des nouvelles vraies ou controuvées pour charmer les soucis de ses malades, et qui eut l’esprit ensuite de tirer de ses cancans un parti plus avantageux en s’en occupant plus sérieusement.
Les Anglais, qui ne sont jamais les derniers à réclamer leur part de tout honneur, veulent absolument avoir inventé les gazettes. Personne n’a daigné encore le leur contester.
« Histoire anecdotique et morale des proverbes et dictons français. » Joséphine Amory de Langerack, Lille, 1883.
Les origines du journalisme
 Le Précurseur d’Anvers, qui a publié d’intéressants documents sur l’histoire du journalisme, rappelle, non sans orgueil, que c’est a un Anversois, Abraham Verhoeven, que revient l’honneur d’avoir fondé le journal dans la stricte acception du mot.
Le Précurseur d’Anvers, qui a publié d’intéressants documents sur l’histoire du journalisme, rappelle, non sans orgueil, que c’est a un Anversois, Abraham Verhoeven, que revient l’honneur d’avoir fondé le journal dans la stricte acception du mot.
Ce journal, intitulé Niewe Tijdingen, parut d’abord à des intervalles inégaux, mais, dès l’année 1621, il prit un cours régulier, paraissant tous les deux jours avec des illustrations. A cette époque, les autres pays, y compris l’Angleterre, ne produisaient que des feuilles volantes.
En revanche, c’est la France qui donne le jour au premier journal sérieux, la Gazette, fondée, comme on sait, en 1631, à Paris, par Théophraste Renaudot, médecin du roi.
Le premier numéro de la Gazette de France, qui parut le 30 mai, contenait des nouvelles de Constantinople (2 avril), de Rome (26 avril), de la Haute-Allemagne (30 avril), de Freistad en Silésie (1er mai), de Venise (2 mai), d’Amsterdam (17 mai), d’Anvers(24 mai), etc. C’était là, pour le temps, des informations remarquablement rapides.
Ce Théophraste Renaudot, à qui la France devrait bien une statue, comme la Belgique en devrait bien une à Abraham Verhoeven, était un écrivain distingué et un administrateur modèle. Le succès de la Gazette de France fut très grand. Dès 1633, Renaudot parlait en homme sûr de son affaire. Il avertissait les princes qu’ils perdraient leur temps à vouloir fermer le passage à ses nouvelles, « attendu, disait-il, que c’était là une marchandise dont le commerce ne saurait se défendre, et qui tient en cela de la nature des torrents, qu’elle se grossit par la résistance ».




Vous devez être connecté pour poster un commentaire.